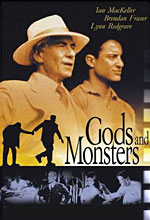 Traduit stupidement par "Ni Dieux Ni Démons" (!) et inédit en salle par chez nous malgré une avalanche de récompenses internationales dont l’Oscar du meilleur scénario adapté en 1999, ce magnifique film de Bill Condon évoque les derniers jours de James Whale, réalisateur du célébrissime Frankenstein de 1931 avec Boris Karloff et de sa suite La Fiancée de Frankenstein auquel le titre original fait référence*.
Traduit stupidement par "Ni Dieux Ni Démons" (!) et inédit en salle par chez nous malgré une avalanche de récompenses internationales dont l’Oscar du meilleur scénario adapté en 1999, ce magnifique film de Bill Condon évoque les derniers jours de James Whale, réalisateur du célébrissime Frankenstein de 1931 avec Boris Karloff et de sa suite La Fiancée de Frankenstein auquel le titre original fait référence*.Tiré du livre de Christopher Bram "Le Père de Frankenstein" et coproduit par Clive Barker, l’intrigue s’appuie sur le mystère qui entoure la mort du réalisateur en 1957 : gravement malade, il fut retrouvé inanimé dans sa piscine à Hollywood sans que l’on sache s’il s’agissait d’un suicide, d’un accident ou d’un meurtre. Comme il s’adonnait à la peinture depuis qu’il avait quitté le cinéma en 1949, une grande quantité de reproductions et de nus fut retrouvée dans sa villa après sa disparition. Le film s’attache à rassembler ces éléments en imaginant la relation ambiguë qui s’établit entre le peintre et son dernier modèle : son jardinier.
James Whale définit
Irrité par le culte voué aux deux films auxquels il préfère L’Homme Invisible et Show Boat, mais sachant très bien jouer de cette notoriété pour obtenir ce qu’il désire, Whale manipule son entourage avec gourmandise. Sa très pieuse gouvernante hongroise Hannah tout d’abord, éternelle compagne réprobatrice témoin de ses frasques, son ex compagnon le producteur David Lewis, mais aussi les journalistes venant l’interviewer et finalement ce jeune jardinier un peu bas du front dont il s’entiche et qui comme lui porte de profondes blessures intimes. Si l’homosexualité du cinéaste est bien sûr indissociable de l’histoire du film comme elle l’était de sa propre vie, elle ne constitue pas ici le propos principal. Toute l’intelligence des auteurs est justement d’en faire un élément ordinaire parmi d’autres. D’ailleurs Boone ne partage aucunement les goûts de Whale dont les desseins se révéleront ne pas être tout à fait ceux que l’on pouvait imaginer…
Il fallait le talent et le charisme de l’immense comédien Ian McKellen pour donner au personnage de Jimmy Whale toute l’ambiguïté, le charme du vieux dandy lucide et caustique, jusqu’à la fin en quête d’une liberté absolue. Trouvant là sans doute l’un de ses plus grands rôles au cinéma, l’acteur est bouleversant, drôle, malicieux, cassant aussi. A noter l’implication de McKellen l’activiste qui avait conscience de la portée sociale du film, Whale refusant comme lui de vivre sa sexualité dans le placard.
Face à lui Brendan Fraser montre qu’il vaut nettement mieux que les pantalonnades dans lesquelles il semble se spécialiser. Il est ici étonnant de justesse et de vulnérabilité sous son physique de colosse, pendant glamour et plein de santé du Monstre interprété jadis par Boris Karloff. La ressemblance n’est évidemment pas un hasard puisque tout le film s’attache à tisser des liens entre passé et présent, reliant ainsi les désirs et les blessures du cinéaste à son oeuvre. Gods and Monsters trouve toute sa force et son originalité dans cette façon souvent onirique de mettre en image la vie d’un homme grâce à des évocations surgissant tels des rêves ou des hallucinations. L’une des plus poignantes est celle où, dans les décors stylisés de Frankenstein, Boone figurant le Monstre conduit Whale par la main vers une tranchée jonchée de cadavres de soldats.
Le film s’achève sur une scène extraordinairement touchante qui serait en partie une idée de Brendan Fraser. Elle clôt de manière fort poétique une œuvre magistrale, sensible, tout en finesse. Sans doute l’un des plus beaux hommages au cinéma jamais réalisé. Indispensable.
* "To a new world of Gods and Monsters !" est le toast porté par le Dr Prétorius lors de la création de la Fiancée de Frankenstein.





