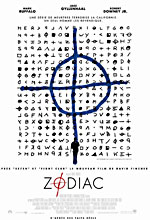Le cinéma de genre d'outre-Manche se porte bien, merci. Voilà un nouvel exemple qui démontre qu'avec peu de moyens, peu d'expérience – et peu d'idées, soyons justes – mais avec un talent certain, il est possible d'obtenir un film d'une redoutable efficacité. De ce côté-ci du Channel, on en peut qu’envier cette capacité à exploiter au mieux un décor familier sans tomber dans le banal et ennuyeux téléfilm singeant maladroitement la production US.
Le cinéma de genre d'outre-Manche se porte bien, merci. Voilà un nouvel exemple qui démontre qu'avec peu de moyens, peu d'expérience – et peu d'idées, soyons justes – mais avec un talent certain, il est possible d'obtenir un film d'une redoutable efficacité. De ce côté-ci du Channel, on en peut qu’envier cette capacité à exploiter au mieux un décor familier sans tomber dans le banal et ennuyeux téléfilm singeant maladroitement la production US.L'exploit m'avait déjà épaté avec Isolation, minuscule film irlandais qui exploitait de manière sidérante le cadre d'une ferme ordinaire, toute en bottes caoutchouc, averses et fosse à purin. The Thing chez la Veuve Couderc, oui c'est possible : avec 2 sous et un étonnant sens du cadre et de l'ambiance poisseuse, Billy O'Brien emportait le morceau haut la main dès ce premier film à l'intrigue pourtant convenue.
Avec Eden Lake, James Watkins signe lui aussi sa première réalisation - mais son troisième scénario horrifique - en illustrant le thème du Survival. En cette période où il en sort presque un par semaine, il fallait oser. D'autant que, là non plus, pas question d'aller chercher de spectaculaires mutants hydrocéphales au fin fond d’une exotique Vallée de la Mort ou ressusciter un improbable maniaque zombie affublé d’un masque. Non : rien que de la bonne vieille forêt ordinaire et des agresseurs qui pourraient être les gamins du coin.
Certes, sur la trame du jeune couple citadin fringant et sexy confronté à de jeunes autochtones vindicatifs - qui n'est pas sans rappeler notre honorable Ils national - James Watkins égrène tous les rebondissements auxquels on peut s’attendre et n'évite pas les clichés. Mais en connaisseur, il sait aussi surprendre en décalant d'un poil les conventions mille fois vues. Beaucoup d’événements arrivent plus tôt ou plus tard, des espoirs semés s’avèrent des impasses, le tout déstabilisant suffisamment le spectateur pour qu'il soit bien vite captivé par un suspens inattendu. Captivé et épouvanté aussi, tant les passages horrifiques sont effroyables même s’ils révèlent, comme toujours, de... "stupéfiantes" capacités physiques de la part des victimes.
Mais au premier rang des surprises, figure bien sûr l’identité des agresseurs. De ce choix découle la singularité de ce Eden Lake. Car ils sont si ordinaires que le film s’amuse même un temps à jeter le trouble : sont-ils les futurs bourreaux ou bien est-ce un leurre ? Contrairement à l’essentiel de la production de Survivals qui aborde rarement le point de vue de l’agresseur pour n’en faire qu’une puissante et aveugle machine à tuer, Watkins s’attache à décrire le cheminement qui conduit à l’escalade vers l’horreur : les prémices, l’élément déclencheur, mais aussi le doute chez ces tortionnaires en culottes courtes quand il s’agira de passer à l’acte. Doute que l’on retrouve même du côté des victimes qui ne savent plus toujours déterminer avec certitude quand elles sont ou non en état de légitime défense face à ces enfants sauvages dotés de téléphones portables et vélos BMX.
Le réalisateur trouve là son idée maîtresse, mais aussi la source d’un certain malaise quant à son interprétation. Certains y verront une préoccupation sociologique pointant la désintégration sociale des laissé-pour-compte de l’Angleterre néolibérale, ou bien au contraire une redoutable démagogie réactionnaire dénonçant le caractère dégénéré de "beaufs" avinés et violents potentiellement meurtriers de père en fils. Difficile de trancher en vérité tant le réalisateur brouille le message. Les victimes sont trop parfaites à tous égards pour ne pas représenter des modèles, mais les agresseurs ne sont pas non plus des miséreux entassés dans des cités délabrées. L’inattendu et épouvantable final souligne encore davantage cette ambiguïté que Watkins semble vouloir délibérément laisser à l’appréciation du spectateur.
Quoiqu’il en soit, un premier film en forme de Survival percutant, remarquablement réalisé et interprété où l’on finit par se poser des questions : voilà qui n’est pas banal.