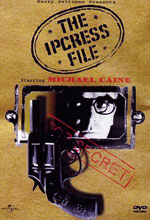Artisan autodidacte et perfectionniste, dispendieux comme personne et un peu long à la détente, le cinéaste se fait pourtant connaître sur des bases plus modestes : avec son premier Terminator ou même Aliens, une suite aussi inattendue qu'efficace au film de Ridley Scott, il surprend par sa faculté à livrer des œuvres musclées, spectaculaires mais bien moins coûteuses qu'elles en ont l'air. Issu du monde des effets spéciaux et de la très pingre écurie de Roger Corman, James Cameron connaît bien l'envers du décor et n'a pas son pareil pour afficher 3 dollars à l'écran là où un seul est dépensé.
Mais à partir d'Abyss, tout bascule : le budget devient un gouffre sans fond, le tournage une épopée et le film lui-même un événement par ses nombreuses performances techniques et artistiques. Contrepoint à sa réputation de redneck un peu trop porté sur les armes et la chose militaire, Abyss prend même la forme d'un immense message pacifiste. Malgré un succès mitigé, le film est une réussite qui constitue à ce jour son film le plus fort, le plus original et sans aucun doute le plus personnel.
Pour se refaire une santé financière, Cameron revient ensuite à son robot porte-bonheur et livre un Terminator 2 surproduit, consensuel et (déjà) vaguement aseptisé. Le statut de super star de Schwarzenegger - qui pense déjà sans doute à sa future carrière politique - s’accommode désormais mal du personnage d’androïde assassin qui se transforme cette fois en gentil protecteur d’enfant, dénaturant considérablement le thème originel d’un premier opus dépressif en diable. Mais grâce à son efficacité punchy et surtout des effets spéciaux numériques révolutionnaires, ce T2 remporte la mise et hisse à nouveau son créateur au sommet du box office.
Passons sur True Lies - Claude Zidi adapté par James Cameron, on se pince - pour arriver à Titanic, film de tous les records : budget, recettes, tournage, décors, effets spéciaux, tout y est kolossal, jusqu'au métrage lui-même qui atteint 3h15. Une exception cependant : le scénario. Manichéenne et convenue, centrée sur un triangle amoureux à l'eau de rose, l'aventure humaine qui accompagne la catastrophe n'est, sur le papier, guère passionnante. Pourtant la magie opère grâce au talent d’un couple de comédiens désormais mythique, à l'hyperréalisme terrifiant de la reconstitution et finalement au souffle romanesque qui emporte le spectateur presque malgré lui. C'est avec la même recette que James Cameron fait son retour aujourd'hui. Mais Avatar pousse cette fois à l'extrême le grand écart entre la forme et le fond.
Inutile de s'étendre sur la forme, tout a été déjà dit par la promo, la critique et vos amis. Oui, Avatar est visuellement prodigieux, oui le relief est saisissant, oui le film marque son époque par le bond qualitatif dans l'utilisation du numérique, par sa troublante homogénéité entre réalité et virtuel. Somptueux livre d'images flamboyantes, vertigineuses parfois, Avatar est une éclatante lanterne magique qui vous colle au fauteuil. Seulement voilà, toute cette magie, ce travail de visionnaire exigeant illustre une histoire d'une impardonnable paresse. Chaque phrase ou péripétie, le plus minuscule rebondissement a déjà été ruminé mille fois pour former au final un épuisant florilège de poncifs lénifiants. Du coup, sur 2h40 de film, l'émerveillement se teinte peu à peu d'indifférence, voire d'irritation pour finalement flirter avec l'ennui.
D'autant que cette fois, rien ni personne ne vient relever cette soupe passablement rance : pas de comédiens talentueux ou charismatiques ni de situations dramatiques fortes, aucun climax ni suspens, aucune astuce de scénario, bref : zéro surprise. Même le final renonce à exploiter les maigres idées semées ici ou là : l'évocation d'une planète presque consciente, connectée en un réseau chimique pouvait présager une conclusion dantesque, symbolique, tel un Miyazaki survitaminé. Mais nous n'avons droit qu'à une simple bataille entre ptérodactyles pandorins et vaisseaux tout droits sortis d'Aliens. Comme le reste, c'est bien fait, mais d'une immense pauvreté compte tenu de l'ambition du projet.
Et puis usé jusqu'à la corde ce redoutable catalogue de clichés exotiques pour occidental "tout confort" qui, entre 2 pétitions Facebook et une livraison de sushis à domicile, se rêve en pagne dans un Eden fantasmé façon parc d'attractions. Ah le bon peuple où l'on est chef de naissance, où l'on choisit sa femme comme un bibelot, où les accouplements sont prévus dès l'enfance, où une Vérité sort de la bouche de la première cartomancienne venue, où les Anciens (surtout les morts) ont toujours raison, où l'on tue mais en se donnant des airs de Grand Sage. Ah l'aimable tribu qui a tout compris à la vie, mais qui a quand même besoin qu'un bon vieux Marines bas du front les prennent par la main quand il s'agit de passer aux "choses sérieuses". Bons Sauvages. Pour un peu, ils avaient le rythme dans le sang dites donc...
Pesante cette leçon de vie où le héros mitouille devant des lianes fluo, en communion avec une nature gaïesque, forcement maternelle, envoyant des messages chaussés de plomb à propos "des Hommes qui ont tué la Terre". Méchants humains. Tous. Tandis que les Na'vis eux, se contentent d'affirmer qu'il s'agit de leur planète, qu'elle leur appartient haha. D'ailleurs elle est chouette cette supposée "connexion" avec les autres créatures qui est en réalité un lavage de cerveau réduisant les animaux à des esclaves dont on s'approprie carrément le système nerveux. Big Brother peut aller se rhabiller.
Bref, sous ses allures naïves et infantiles, l'intrigue trouve le moyen de véhiculer une bonne flopée d'idées douteuses et contradictoires dont il faut reconnaître qu’elles sont synchros avec l'idéologie dominante du moment. Ceci expliquant sans doute la complaisance de la critique bien pensante, célébrant poésie et pertinence là où elle moque impitoyablement la légèreté d'un Star Wars, le conservatisme d'un Lion King ou traque le plus fantomatique message crypto national-socialiste d'un 2012.
D'ailleurs si, comme le dit Cameron, Avatar parle de la Terre, de nous, si le film est censé faire "réfléchir sur notre rapport à la nature", pourquoi transposer l'histoire sur une planète lointaine ? Pourquoi cet anthropomorphisme prétentieux qui va piller l'Afrique, la vraie, celle qui souffre ici et maintenant des mêmes exactions dénoncées dans le film, pour n'en faire qu'un folklore de pacotille, condescendant et propret digne des années 30 ? Faut-il donc aujourd'hui repeindre en bleu des comédiens Noirs et leur coller des oreilles de lapin pour les rendre acceptables et nous émouvoir, des fois qu'ils ressemblent un peu trop à nos voisins humains ?
Bien sûr tout cela serait sans doute moins irritant, moins décevant, si James Cameron ne se posait pas en directeur de conscience mystique ni ne tambourinait que des années furent nécessaires pour mener à bien le film et son scénario.
Finalement, à l'opposé d'un Spielberg qui achète sa liberté en alternant commandes et œuvres personnelles, James Cameron semble devenir inexorablement soluble dans le Hollywood le plus stérile. Après le succès sans précédents de Titanic, on pouvait imaginer que l'auteur ambitieux et efficace d'Abyss mette à profit cette liberté pas seulement dans le choix des décors ou la qualité du relief. Cameron se contente ici d'un long et somptueux film sans âme, articulé sur des lieux communs à la fois simplistes et opportunistes, radotés à l’infini tel un vieil ordinateur à scénarios de chez Disney, l'humour et la bonne humeur en moins.