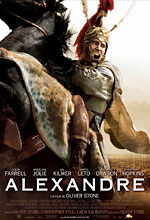Après l'envoûtant et surprenant Prestige, Christopher Nolan est de retour avec son Batman plus rebooté que jamais. Coécrit avec son frère Jonathan et coproduit par sa femme Emma Thomas, cette énorme production détourne les standards du gros film de majors pour aller flirter l’air de rien du côté du film d’auteur. A l’instar des X-men de Bryan Singer, des Batman de Tim Burton ou même du Superman de Richard Donner, The Dark Knight démontre à nouveau que les meilleures adaptations de comics sont l’œuvre de réalisateurs à forte personnalité qui s’approprient les thèmes en évitant d’illustrer docilement l’œuvre originale souvent un peu simpliste. Fort du succès presque inattendu de son extraordinaire Batman Begins, Nolan enfonce donc le clou avec ce second volet plus personnel encore.
Après l'envoûtant et surprenant Prestige, Christopher Nolan est de retour avec son Batman plus rebooté que jamais. Coécrit avec son frère Jonathan et coproduit par sa femme Emma Thomas, cette énorme production détourne les standards du gros film de majors pour aller flirter l’air de rien du côté du film d’auteur. A l’instar des X-men de Bryan Singer, des Batman de Tim Burton ou même du Superman de Richard Donner, The Dark Knight démontre à nouveau que les meilleures adaptations de comics sont l’œuvre de réalisateurs à forte personnalité qui s’approprient les thèmes en évitant d’illustrer docilement l’œuvre originale souvent un peu simpliste. Fort du succès presque inattendu de son extraordinaire Batman Begins, Nolan enfonce donc le clou avec ce second volet plus personnel encore.Durant presque 2h30, le film déroule une troublante succession de chapitres et de scènes presque autonomes - au point d’être parfois disparates - qui parvient peu à peu à élever cette banale histoire de super héros au rang de tragédie. Au point où les souvenirs du Parrain ou de Scarface me sont revenus à l’esprit durant la projection. Car en évitant presque toute l’imagerie comics et en s'attachant à rendre réalistes les actes et les motivations de personnages ambigus et violents, le film chasse ouvertement sur le terrain du thriller policier et de la fresque maffieuse. L’injection d’une dose d’affaires véreuses et de mafia internationale ne fait qu’amplifier cette impression.
Au passage exit le Gotham de folklore, le flamboyant manoir Wayne et sa techno-gothique Batcave, place au réalisme vitré et bétonné des grandes mégalopoles. Et si les inévitables scènes spectaculaires à coup d’explosions et de cascades vertigineuses sont au rendez-vous, Nolan marque bien davantage les esprits avec une petite devinette et un simple crayon. Entièrement focalisé sur ses personnages et leurs trajectoires tragiques à des degrés divers, le cinéaste s’approprie totalement le mythe en allant jusqu’au bout d’une vision humaine mais désespérée. A ce titre le sort de l’héroïne résume bien l’audace et l’intransigeance de la démarche. Là où ce retour au réel pouvait affadir le mythe, Christopher Nolan en profite au contraire pour mettre en oeuvre un lent mais implacable crescendo dramatique servi par une distribution de rêve.
Le très charismatique Heath Ledger est remarquable dans le rôle d’un Joker new-look plus proche du serial killer que du clown malfaisant et hystérique mais il serait injuste de concentrer toutes les louanges sur sa seule prestation. Car si le Joker est lui-même de bout en bout, Harvey Dent lui, devient Two Faces sous nos yeux. Aaron Eckhard rend formidablement crédible ce destin tragique qui le conduira d'un avenir politique brillant à la folie meurtrière et suicidaire. Son physique de golden boy et son jeu impeccable lui permettent de passer de l’un à l’autre avec une grande aisance et sans excès. Plus présent à l’écran que son rival psychotique au sourire balafré, on peut même se demander si le réalisateur n’était pas davantage intéressé par cette longue descente aux enfers que par la très linéaire folie destructrice du Joker. Et si le film était d’abord l’histoire d’Harvey Dent ?
Car le Dark Knight du titre est lui réduit à un personnage de second plan. Traversant le décor les mains dans les poches et le visage plus inexpressif que jamais, Bruce Wayne/Christian Bale réussit l’exploit d’être moins présent que son majordome Alfred incarné par un émouvant Michael Caine qui vous sert la gorge en une phrase et un regard. Comme si Christopher Nolan avait compris que ne pouvant rivaliser avec des comédiens de l’envergure de Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine, Heath Ledger ou même Aaron Eckhard, il était préférable de laisser Christian Bale en retrait et l’utiliser pour sa stature et une certaine présence.
Au registre des faiblesses, Nolan n’évite pas une certaine confusion dans sa manière d’accumuler plusieurs films en un seul, passant un peu du coq-à-l’âne sans se donner toujours le temps d’exploiter ce qu’il met en place. Cet aspect est particulièrement évident dans le premier tiers du film avec cette obscure intrigue d’associé chinois expatrié et de cambriolages multiples. Impossible également de faire l’impasse sur certaines idées sécuritaires tendancieuses, en particulier en ces temps d'Usa Patriot Act. On peut voir là des similitudes de fond avec l'incontournable Dark Knight Returns de Frank Miller où s’affrontaient déjà idées extrêmes et personnages tourmentés sur fond de désillusion morale et de société déliquescente. Malheureusement cet aspect semble désormais presque inséparable du personnage, ici souligné sans doute par un environnement résolument réaliste.
Au final, malgré un effet de surprise un peu émoussé depuis le précédent film de la série, ce second volet du duo Batman/Nolan se hisse incontestablement au sommet du genre sur un registre tout à fait inattendu. Même si comme pour Le Prestige, persiste cette impression diffuse mais tenace qu’il manque comme un souffle ou un brin de folie pour que le film accède au rang de chef-d’œuvre.