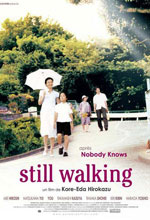Ridley Scott
l'affirme depuis toujours : tourner une suite à l'un de ses films ne
l'intéresse pas. De fait, malgré quelques copieux succès à son actif, il
se refuse à l'appel du revenez-y. Au point de bâtir au fil du
temps une filmographie, certes, très inégale, mais d'un éclectisme
certain : les genres eux-mêmes y sont rarement visités plusieurs fois.
Et même si son Hannibal est bien une sequel, il fait suite à un Silence des Agneaux signé Jonathan Demme : il ne s'agit donc pas de réaliser du Ridley Scott 2.0.
Ridley Scott
l'affirme depuis toujours : tourner une suite à l'un de ses films ne
l'intéresse pas. De fait, malgré quelques copieux succès à son actif, il
se refuse à l'appel du revenez-y. Au point de bâtir au fil du
temps une filmographie, certes, très inégale, mais d'un éclectisme
certain : les genres eux-mêmes y sont rarement visités plusieurs fois.
Et même si son Hannibal est bien une sequel, il fait suite à un Silence des Agneaux signé Jonathan Demme : il ne s'agit donc pas de réaliser du Ridley Scott 2.0. Première véritable concession à cette certitude que "ce qui est fait n'est plus à refaire" le remaniement de son Blade Runner en 1997. La version sortie en 1981 avait en effet subi des modifications importantes de la part de la production. Blade Runner ayant accédé entre temps au rang de chef-d’œuvre, Scott peut se permettre de remettre son film d'aplomb. Mais lorsque la Fox lui demande de retoucher également Alien pour sortir un "director's cut" opportuniste surfant sur la mode du supplément bidon, Scott commence par refuser. Pas question de réinjecter la fameuse scène dite "des cocons" juste pour réaliser le fantasme d'une génération de fans. Mais la major hollywoodienne est intraitable : Alien tripatouillé se fera avec ou sans lui. Scott cède tout en reconnaissant le faire pour l'argent et parce qu'il préfère que ce soit lui plutôt qu'un autre. Contrairement à Blade Runner, ce nouveau montage ne présente aucun intérêt. Pire : en brisant la fluidité de la dernière partie du film, la réintégration de la scène "mythique" prouve à quel point il est essentiel de la laisser à la poubelle. C'est dire si vendre cette mouture comme une volonté de l'auteur au profit de l'intégrité de l’œuvre tient du révisionnisme créatif. Ironie de l'Histoire : une joute de même nature présidera à l'existence de Prometheus.
Après les affligeants Alien Vs Predator 1 et 2, la Fox décide de confier la production de la franchise à Scott Free, la firme créée et dirigée par Ridley Scott et son frère Tony. Ce qui semble de prime abord une excellente idée se révèle un feuilleton de quatre ans où priment les rapports de force. Les nouveaux partenaires annoncent rapidement leur intention de mettre en chantier le prochain opus en revenant aux sources de la saga. Même si aucun script n'est encore écrit, on apprend que l'histoire se déroulera avant le premier film. Exit donc l'emblématique Ripley incarnée par Sigourney Weaver. Le concept est risqué mais depuis le grotesque Alien Résurrection, on sait que la présence du personnage n'est en rien un gage de qualité.
Peu à peu, les ingrédients divulgués se font plus inquiétants : notamment l'accent mis sur le monde dont est issue la créature aux commandes du vaisseau extra-terrestre découvert dans le film originel. Sorti de l'imagination du peintre Giger, le fameux "space jockey" fut conçu comme une sculpture fossilisée sans se soucier de réalisme anatomique. La perspective de voir évoluer des foules de ces E.T. remaniés par n'importe quel production designer laissait craindre le pire. Avec raison on le verra. Pour l'heure on croise les doigts : Ridley est là, et s'il y a bien un domaine où il excelle c'est celui des choix esthétiques.
Seulement voilà, Ridley n'y est plus : fidèle à son manque d'intérêt pour les suites, il annonce que le projet sera conduit par un obscur réalisateur allemand auteur de courts-métrages, se trouvant être le petit ami de sa fille. On a vu CV plus excitant. On passe donc de l'inquiétude à l'épouvante, la Fox aussi : pas question que Ridley se dérobe et avec lui le principal argument marketing légitimant le redémarrage de la série. Mais Scott tient bon et le projet disparaît quelque temps des radars.
La Fox sort alors une nouvelle fois sa massue argumentaire : si Ridley Scott ne réalise pas le film, sa société Scott Free se verra retirer l'exploitation de la franchise Alien. Et ça marche à nouveau : Scott revient aux commandes. En tant que futur spectateur, c'est peu dire que l'enthousiasme premier s'en trouve refroidi. Concevoir et surtout réussir la suite d'un film extraordinaire n'est jamais chose aisée, en imaginer un cinquième avatar relève carrément de l'exploit. Mais si le maître d’œuvre s'y colle à regret, les chances de succès deviennent infimes.
Au fil du temps la prequel officielle d'Alien laisse place à un machin hybride qui semble concilier la non-envie de Scott à la nécessité contractuelle d'en faire un film de la saga. La fuite d'un synopsis construit de bric et de broc annonce un brouet mystico-kitch de la pire espèce. L'arrivée du scénariste de l'improbable Cowboys et Envahisseurs ne rassure pas davantage. Comme pour conjurer le sort, les éléments de langage marketing pilonnent sur le thème du scénario brillant. La découverte de la bande-annonce n'est résolument pas de bon augure : casting de top models, imagerie quelconque et surtout cet insupportable quizz vendeur de souvenirs directs ou détournés (ah ces œufs-mais-pas-tout-à-fait). Mais on veut y croire tout de même, la catastrophe n'est jamais sûre et la promesse est belle. C'est peu dire qu'elle n'est pas tenue.
Expédions les éléments évidents d'un désastre annoncé : le scénario est bel et bien d'une insondable platitude. Incohérent, écrit au fil de la plume pour remplir le vide entre les pataudes références au film original, l'intrigue s'écoule sans tension, sans enjeux, sans aucune surprise et de manière pas toujours très claire. Chaque rebondissement est téléphoné ou stupide, les personnages sont inconsistants et les motivations confondantes de bêtise. Lestée par un "propos" mystico-philosophique bien pensant écrit par ordinateur et soulignée par une musique mélo, l'histoire oscille entre l'eau tiède et le comique involontaire tant le comportement des protagonistes semble souvent incongru : deux scientifiques égarés aux agissements de débiles mentaux, la décontraction ahurissante de l'équipe face à l'inconnu, la soirée "sexy" en tongs et kimono de lin, les acrobaties de l'héroïne fraîchement opérée, l'irruption d'un zombie bondissant, le suicide au lance-flamme, l'explication subite du commandant, un "humour" ponctuel qui vient comme un cheveux sur la soupe. Et la liste est loin d'être exhaustive.
Les comédiens n'aident pas à faire passer la pilule : hormis Michael Fassbender qui esquisse un personnage intéressant mais jamais exploité, la fadeur de ses collègues est immense : Noomi Rapace fait le job sans brio, Logan Marshall-Green semble sortir d'une pub Diesel, quant aux autres, ils n'existent pas. Une mention pour Charlize Theron parcourant le décor à grands pas de top model, surjouant une executive woman glaciale comme on n'en voit plus depuis les pubs l'Oreal des années 90. Guy Pearce lui, peine à faire passer quelques émotions à travers un maquillage calamiteux, option d'autant plus stupide qu'elle est parfaitement inutile. Y aurait-il pénurie d'acteurs âgés ?
Côté esthétique, ce n'est pas mieux. À l'image du film tout entier, Scott aligne paresseusement allusions lourdingues et déjà-vu plan plan. Le décorum humain n'est jamais choquant mais désespérément standard : on cherche en vain la moindre invention ou originalité visuelle ou, à défaut, un soupçon de réédition inspirée. Au lieu de quoi on y manipule des fenêtres holographiques comme dans n'importe quel action movie techno. Côté tumulus extra-terrestre, c'est nettement plus grave : la reprise de l'univers Gigerien est affreusement mal digérée, grossière même : de vilains décors sans âme, tout en grosses nouilles grises. En guise de clou du spectacle, la salle de commande avec sa flûte saugrenue, ses boutons mous et son insignifiant planétarium piloté par un space jockey télescopique frôle le mauvais goût et, disons-le, un colossal je-m'en-foutisme. Les extra-terrestres albinos et bodybuildés sont hors charte mais on remercie néanmoins les auteurs de nous avoir épargné leurs cavalcades en "combinaison" : ce que l'on voit de leur cadavre est tout simplement indigent.
Et les méchants xénomorphes alors ? Parce qu'il y en a évidemment, cahier des charges oblige. C'est d'ailleurs le seul élément qui n'est pas déjà visible dans une bande-annonce éventant consciencieusement les maigres effets de surprise potentiels. Vous aimez les faux œufs en forme de jarre ? Vous adorerez le pseudo face hugger façon calmar. Le film s'achève en apothéose avec l'apparition d'un Alien like aussi moche et mal foutu que celui du non moins mémorable hybride clôturant Alien Résurrection.
Au final, ce Prometheus qui prétend pompeusement ouvrir une nouvelle saga n'est qu'un film bâclé et faussement ambitieux, un concept creux de pur marketing à l'image de cette récente prequel The Thing en forme de clone absurde. C'est-à-dire tout ce que James Cameron et David Fincher avait évité avec leur vision de l'univers Alien. Malgré des contraintes de productions identiques, Aliens, le Retour et Alien 3 avaient su inventer chacun un style très personnel qui fait encore référence dans le cinéma d'aujourd'hui. Enrichis d'une esthétique puissante et inspirée, d'ambiances cohérentes et fortes, les deux suites développaient pour le meilleur un premier film à la structure simple mais d'une créativité infinie. Ici ne demeurent que le cynisme et un savoir-faire stérile réduit à son strict minimum dont assurément personne jamais ne s'inspirera. Réalisé par un tâcheron anonyme, Prometheus ne serait qu'une soupe insignifiante. Porté par Ridley Scott, c'est une honte.