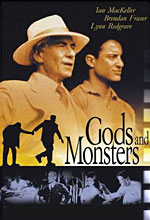Comme presque tous les ans à la période des fêtes, une chaîne de télé se dévoue pour nous rediffuser l’adaptation du conte de Charles Perrault. Tant mieux, car le très joli film de Jacques Demy garde tout son charme quarante ans après sa réalisation. Et puis c’est toujours mieux que cette gourde de Sissi.
Comme presque tous les ans à la période des fêtes, une chaîne de télé se dévoue pour nous rediffuser l’adaptation du conte de Charles Perrault. Tant mieux, car le très joli film de Jacques Demy garde tout son charme quarante ans après sa réalisation. Et puis c’est toujours mieux que cette gourde de Sissi.Troisième comédie musicale avec le compositeur Michel Legrand après les célébrissimes Parapluies de Cherbourg et Demoiselles de Rochefort, Peau d’Âne est en revanche moins chanté que ses prédécesseurs et s'en tient à des chansons illustrant les moments clefs de l’intrigue. Le résultat est plus facile d’accès et présente en apparence une forme proche des productions Disney. En apparence seulement, car Jacques Demy prend soin de garder tous les aspects les plus symboliques qui font des contes traditionnels bien autre chose que de simples histoires colorées destinées aux tout-petits. Ici l’inceste est clairement le thème central de l’intrigue puisqu’un Roi, veuf inconsolable, ne trouve que sa propre fille digne de remplacer la défunte Reine à ses côtés. Aidée par sa marraine la Fée des Lilas, la Princesse n’a d’autre choix que de fuir le royaume incognito sous les traits d’une souillon habillée d’une peau d’animal. Inimaginable au pays de Mickey !
Comme l’a écrit Bruno Bettelheim dans sa Psychanalyse des Contes de Fées, ces histoires ancestrales n’évitent pas d’aborder les problèmes les plus cruciaux de l’existence contrairement aux œuvres plus récentes qui tendent à construire un univers sécurisant conforme avant tout à l’idée que veulent se faire les adultes de leur progéniture idéalisée. Les contes originaux, souvent affinés durant des siècles voire des millénaires, entendent plonger carrément le jeune lecteur dans les difficultés existentielles qu’il est amené à affronter durant sa construction psychique. Toute l’intelligence des contes est d’aborder ces sujets complexes sous forme d’œuvres d’art qui captivent avant tout par leurs qualités littéraires et narratives. En édulcorer les aspects jugés les plus "choquants" sous prétexte de les rendre abordables aux plus jeunes les vide de leur sens.
Conscient de la richesse du sujet, Jacques Demy expose donc clairement l’argument du conte sans l’éviter, ni utiliser de langage crypté destiné aux adultes, ni en rire. En cela Peau d’Âne est une exception dans le monde pourtant foisonnant du conte porté à l’écran : il garde sa vertu féerique tout en préservant son caractère le plus profond. Comme l’histoire originale, il permet à chaque âge de la vie de s’y retrouver. Son statut de film culte trouve sans doute là son origine, au même titre que les contes ont su traverser les siècles.
Le cinéaste illustre par ailleurs au mieux (pour l’époque) l’aventure elle-même grâce à une luxueuse direction artistique (pour une production française) et une bonne humeur vivifiante à laquelle Michel Legrand contribue grandement avec son entêtante bande originale reconnaissable dès les premiers accords. Soutenu par une distribution de choix qui voit défiler Jean Marais, Catherine Deneuve, Micheline Presle, Jacques Perrin et Delphine Seyrig, le film séduit, amuse souvent, émerveille parfois. Bien sûr on peut déplorer un jeu manquant de profondeur, une lumière qui ne préserve jamais un coin d’ombre ou une esthétique parfois kitsch, mais heureusement le film est court (1h25) et le rythme soutenu. Au passage le spectateur attentif sourira aux références faites à d’autres contes (Le Chat Botté, Les Fées) et bien sûr au film La Belle et la Bête de Jean Cocteau dont Jean Marais et son pourpoint largement épaulé n’est que l’expression la plus visible.
La Belle et la Bête et Peau d’Âne, deux ovnis survolant un cinéma français si rétif et méprisant face à l’imaginaire, deux chef-d’œuvres hors du temps qui se répondent à vingt-cinq ans d’écart et nous émerveillent intelligemment encore aujourd’hui. Bonnes fêtes !